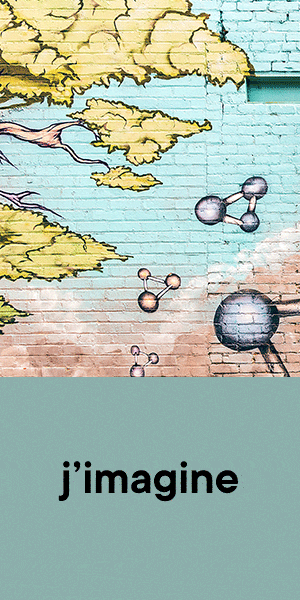Employé au centre de traitement d’Englobe à Montréal-Est. (Photo : Englobe).
14 mars 2019DÉCONTAMINER L’EST : UN DÉFI ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
Alors que l’Est de Montréal évolue tranquillement mais certainement de l’industrie lourde du début du XXe siècle vers l’industrie urbaine plus légère et technologique, son passé, lui, laisse des traces polluantes difficiles à effacer. On parle bien sûr ici des fameux sols contaminés dont le territoire a hérité, notamment de la part de l’industrie pétrolière et de ses dérivés, mais pas seulement. Les chemins de fer, les lubrifiants et solvants industriels, les remblais de sols non conventionnés, font partie de nombreux autres contaminants ou activités contaminantes qui ont également imprégnés les terrains industriels de la métropole au fil des décennies, que l’on trouve particulièrement en grande quantité dans l’Est de Montréal.
En général, les règles environnementales d’aujourd’hui ne permettent plus le démarrage de projets ou la création de nouveaux bâtiments sur les terrains contaminés, même légèrement. Les municipalités, qui livrent les permis de construction sur leur territoire, tiennent aujourd’hui obligatoirement un registre des terrains contaminés tel que stipulé par la Loi québécoise sur la qualité de l’environnement. Cette liste est compilée suivant les avis inscrits au registre foncier qui sont transmis aux municipalités par le ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques du Québec (MELCC).
Selon les estimations les plus conservatrices, environ 20 % de la superficie de l’Est montréalais serait légèrement ou lourdement contaminés. Si on considère que le territoire possède une surface de 130 km2, 20 % représente environ… 279 861 660 pi2.
Des coûts astronomiques
Continuons donc les calculs. Selon Benoit Lamarche, directeur régional d’Englobe, entreprise qui possède le plus grand centre de traitement de sols contaminés dans la région métropolitaine (rue Brodway Nord à Montréal-Est), un sol typique contaminé aux hydrocarbures, facilement décontaminable par solution biologique, la méthode la moins dispendieuse donc (sauf si on parle de phytoremédiation, mais nous y reviendrons plus loin), coûte entre 35 $ et 55 $ la tonne à décontaminer au centre de traitement. Prenons une moyenne de 45 $ la tonne. Et une profondeur de 3 pieds de sol terreux à excaver également en moyenne, ce qui est peu. Pour décontaminer l’Est de Montréal, cela coûterait donc au minimum 279 861 660 x 0,12 tonne x 45 $ = 1 511 252 964 $. Évidemment, nous sommes ici loin d’une évaluation et d’un calcul scientifiques, mais ça donne une idée de l’ampleur du phénomène.
Spécifions que le coût de 35 $ à 55 $ la tonne est celui concernant la méthode de décontamination ex situ, soit de la terre excavée sur un site et transportée au centre de traitement. C’est aussi le prix pour un type de sol contaminé principalement d’hydrocarbures aromatiques pétroliers (HAC) ou de composés organiques volatils (COV) qui se traite biologiquement (à l’aide de bactéries naturelles). Le tarif pour les sols contaminés de métaux ou autres contaminants lourds ou complexes sont beaucoup plus dispendieux dépassant facilement les 200 $ la tonne. Ces sols sont parfois impossibles à traiter et sont simplement disposés ou enfouis dans des sites sécurisés, à fort prix.

Vue aérienne du centre de traitement d’Englobe, Montréal-Est. (Photo : Englobe).
Lorsqu’un promoteur ou une entreprise entame un projet sur un terrain contaminé, ses coûts pour disposer du sol sont donc énormes, sans compter ceux reliés au remblaiement de la zone excavée. Dans certaines circonstances, notamment si le terrain est facilement traitable, il pourrait faire décontaminer le terrain in situ, donc directement sur place direz-vous, ce qui semble plus simple. Mais ce n’est pas évident. Le plus grand obstacle, c’est le temps. «Dans nos installations, bien équipées, on peut réhabiliter un sol légèrement contaminé en quelques semaines, et dans des cas typiquement plus lourds on parle de deux à quatre mois. Installer des systèmes de décontamination in situ c’est plus complexe, plus dispendieux et plus long. Donc les gestionnaires de projet, même si les budgets sont disponibles, n’ont généralement pas le temps d’attendre. Ils veulent commencer à construire le plus vite possible », explique Benoit Lamarche.
Les sols contaminés constituent donc, de par leurs coûts de traitement ou d’élimination par enfouissement, un frein important à la transformation et à la requalification d’anciennes zones industrielles comme on en retrouve beaucoup dans l’Est de Montréal. Le gouvernement caquiste a décidé de s’attaquer directement au problème en annonçant qu’il irait de l’avant dès cette année avec sa promesse électorale d’injecter 200 M $ pour aider à la décontamination des sols à l’Est du boulevard Pie-IX, une première pour la région.
Industrie complexe et encadrée
La décontamination des sols est un secteur d’activité rentable nous ont dit plusieurs intervenants de cette industrie, mais qui malheureusement est encore aujourd’hui elle-même contaminée par quelques joueurs illicites qui font occasionnellement les manchettes, surtout en disposant des sols contaminés (non déclarés) sur des terrains qui ne sont pas prévus et aménagés à cet effet. « C’est un milieu pourtant très encadré, très réglementé. Pour nous et les autres grands acteurs de l’industrie c’est très difficile de tricher, les conséquences seraient catastrophiques pour l’entreprise qui se ferait prendre », affirme Benoit Lamarche. Selon nos échos, la situation perdure surtout à cause du manque d’inspecteurs du gouvernement et par les moyens de coercition qui ne sont pas assez dissuasifs envers les petits entrepreneurs aux méthodes douteuses, mais aussi envers les promoteurs de projets qui ne respectent pas les règles.
L’Est de Montréal compte sur son territoire certains grands acteurs québécois de l’industrie de la décontamination de sols. En effet y sont actifs notamment Sanexen, Groupe C. Laganière et Englobe, dont le centre de traitement à Montréal-Est a longtemps été considéré comme le plus important au pays. L’entreprise canadienne fondée il y a près de 60 ans, dont est actionnaire la Caisse de dépôt et placement du Québec, est spécialisée en génie des sols, des matériaux et de l’environnement. Elle possède pas moins de 64 places d’affaires au Canada et 10 à l’étranger, dont 19 installations de traitement de sols contaminés. L’entreprise a aussi un bureau de consultants à Anjou comptant une vingtaine de spécialistes desservant principalement l’Est de Montréal.
Le centre de traitement de Montréal-Est, situé sur le terrain d’une ancienne pétrolière, compte une superficie de 6 hectares. On y décontamine environ 300 000 tonnes de matière annuellement provenant d’un millier de lots. « La décontamination des sols à cet endroit se fait surtout via le traitement biologique, donc ce sont des bactéries, déjà présentes dans les sols mais que nous allons stimuler et multiplier, qui vont naturellement absorber et digérer les contaminants», nous dit le directeur régional.
Les types de sols traités par cette technique, dont nous ne détaillerons pas ici toutes les nombreuses composantes, variations et les équipements de pointe requis (traitement des eaux, des gaz, des résidus, etc.), sont surtout contaminés par des hydrocarbures aromatiques pétroliers (HAP) et des composés organiques volatiles (COV) tel que spécifié plus haut. On peut observer visuellement ce genre de décontamination par les grands amas de terre rectilignes recouverts par des toiles, ce que l’on appelle dans le jargon des biopiles. Cette technique est parfois utilisée in situ, soit sur le terrain même à décontaminer. On parle ici de contaminants tels que le diesel, essence, les huiles à moteur, les huiles hydrauliques, lubrifiants, certains goudrons, le pétrole brut, etc. « Mais plus il s’agit de composés lourds, ou de métaux, moins la méthode biologique est efficace », explique M. Lamarche. Les sols lourdement contaminés seront alors pour la plupart enfouis dans des sites sécurisés, alors que les sols qui auront été traités seront généralement, encore aujourd’hui, utilisés comme couches de recouvrement dans les dépotoirs. Pour qu’un sol soit considéré comme décontaminé, le traitement biologique prendra « de quelques semaines à quatre mois, selon le degré et le type de contamination du sol », selon M. Lamarche.
Traçabilité des sols
Au départ, lors de la mise en chantier d’un projet, la caractérisation des sols revient la plupart du temps à l’entrepreneur général. C’est lui qui fait les démarches pour se départir des sols contaminés, le cas échéant. « Par la suite, chez Englobe par exemple, nous recevons et analysons le type de sol que veut nous faire parvenir le client. Si on peut le traiter, nous soumissions et si l’offre est acceptée nous prenons alors en charge la matière dès que nous la recevons à notre centre de traitement. Nous sommes ensuite responsables de la matière, et le client est dégagé de toute responsabilité », explique Benoit Lamarche.
La traçabilité des sols devra donc être assurée par l’entreprise qui en prend la charge. « Chez nous chaque camion arrive avec un numéro de manifeste unique. De notre côté nous émettons pour ce chargement un numéro d’autorisation qui contient les résultats d’analyses de la matière et lui assignons un emplacement sur notre terrain. À la fin du traitement, lorsque les analyses d’un laboratoire accrédité par le gouvernement confirment le niveau de décontamination visé, nous consignons la sortie de la matière dans un endroit précis, comme dans tel dépotoir ou tel centre d’enfouissement par exemple. Nous savons donc toujours où se trouvent les sols qui ont transité dans notre centre de traitement », affirme le directeur régional.
Phytoremédiation : l’avenir ou l’exception?
Il existe une autre solution au « dig and dump » et au traitement biologique en biopiles pour réhabiliter un site contaminé, mais elle demande du temps, en fait généralement beaucoup trop de temps pour les promoteurs pour qui « le temps c’est de l’argent ». Il s’agit de la méthode par phytoremédiation, la décontamination par les plantes.
« Un site industriel disons moyennement contaminé, traité en phytoremédiation, peut prendre de cinq à dix ans avant d’être considéré réhabilité selon les normes actuelles. Mais au-delà du temps, les avantages de cette technique sont beaucoup plus grands que toute autre technique conventionnelle de décontamination », affirme Michel Labrecque, conservateur du Jardin botanique de Montréal et chercheur à l’Institut de recherche en biologie végétale, affilié à l’Université de Montréal.
Les avantages de la phytoremédiation sont en effet considérables. En premier lieu, la technique est peu coûteuse, de 10 à 100 fois moins dispendieuse qu’un traitement conventionnel, selon les études. Elle est évidemment plus écologique puisqu’il n’y a pas de transport de terre et ne nécessite pas de machinerie ou d’équipements lourds. La plantation d’une dense végétation vient aussi améliorer la qualité de l’air des environs et génère de la biodiversité puisqu’elle attire des oiseaux, insectes, etc. Et fait non négligeable, elle améliore le coup d’œil car les friches industrielles sont généralement et naturellement pauvres en végétation. « C’est plus agréable de voir un site en phytoremédiation, avec sa densité de végétaux, qu’un site de biopiles que l’on dirait sorti tout droit de la planète Mars ou une vieille friche non entretenue qui sert souvent de dépotoir en bout de ligne. Pour des résidents ou des travailleurs des alentours, c’est tellement plus agréable », soutient M. Labrecque.
Et il y a deux autres avantages importants à la phytoremédiation. Elle permet, jusqu’à un certain point, de débarrasser la terre de plusieurs métaux puisque des végétaux ont la capacité de les récupérer, de les assimiler et parfois même de les stocker dans leur feuillage par exemple. Il suffit par la suite de couper ces plantes ou ces arbres et de les traiter pour récupérer ou détruire les contaminants. « Et les végétaux, ça produit de la biomasse qui peut servir à d’autres fins. C’est un aspect de la phytoremédiation qui fait l’objet d’importantes études en ce moment, notamment dans le domaine de la chimie verte », ajoute le conservateur du Jardin botanique.

Site en phytoremédiation. (Photo : arrondissement RDP-PAT).
Banc d’essai dans RDP-PAT
L’IRBV, dont l’expertise en phytoremédiation est reconnue et sollicitée sur la scène internationale, mais étrangement moins dans son propre patelin, a été mandatée à la fin 2015 par la Ville de Montréal (Service du développement économique) pour entreprendre un projet de décontamination par phytoremédiation dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles. Un banc d’essai de quatre ans a ainsi débuté dès le printemps 2016 à raison de l’aménagement d’un hectare par année en phytoremédiation. Les quatre hectares au total sont tous situés autour des installations de la pétrolière Suncor.
« Nous testons sur ces friches industrielles différentes approches, différentes plantes et différentes combinaisons et nous sommes très fiers des résultats obtenus jusqu’à maintenant, même si c’est vraiment tôt pour arriver à des conclusions. La composition des sols évolue du moins dans la bonne direction et certaines plantes assimilent des métaux comme souhaité », avance M. Labrecque. La grande star actuellement pour l’IRBV, en sol québécois, serait le saule. L’arbre pousse bien, rapidement, et surtout dans un sol pauvre où il multiplie ses racines
Est-ce que la phytoremédiation est une solution d’avenir pour la décontamination des sols, en particulier dans l’Est de Montréal? « Si on avait commencé à utiliser cette technique il y a 10-15-20 ans dans la région, on ne serait probablement pas dans l’urgence d’agir actuellement. Je souhaite que dans les budgets spéciaux annoncés récemment pour la décontamination des sols sur le territoire de l’Est de Montréal, au moins une petite partie soit accordée aux traitements par phytoremédiation parce qu’il y a sûrement pas mal de terrains que l’on sait contaminés mais qui ne seront pas construits ou transformés avant au moins dix ans encore. Il ne faudrait pas répéter les erreurs du passé », affirme Michel Labrecque, qui verrait d’un bon œil la création prochaine d’un OBNL ou d’une coopérative spécialisée en phytoremédiation. « Il y a certainement de la place pour ça au Québec », dit-il.